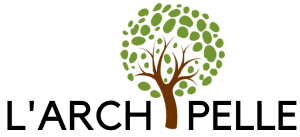Un atelier né d’une ancienne étable
C’est dans une ancienne étable rénovée que Catherine a installé son atelier. Les murs ont été refaits avec des enduits à la chaux, en utilisant un sable local rouge qui donne une teinte naturellement chaude et jaune. Des petits éléments décoratifs comme des morceaux de miroirs ou des motifs gravés viennent ponctuer les murs, dans une esthétique influencée par ses voyages, notamment en Nouvelle-Zélande.
« On aurait pu simplement mettre du carrelage classique, mais on s’est dit : tiens, un petit soleil ici, ça fera sympa. »
Enduits décoratifs et techniques artistiques
L’atelier regorge de surfaces d’essai, où Catherine expérimente des pigments, des textures et différentes techniques : stuc, sgraffito, fresco, incrustations. Chaque mur devient une toile. La terre, le sable, la chaux et les pigments naturels sont mélangés avec soin pour créer des effets marbrés ou des motifs en relief.
« J’ai laissé aller le geste, en musique. Chaque tableau a sa musique de création. »
Elle privilégie des formats plus petits aujourd’hui, après des années à enduire des murs entiers : « J’avais envie de continuer l’exploration des couleurs, mais sur des surfaces plus petites. »

L’art du fresco : quand la chaux devient toile
La technique du fresco consiste à appliquer des pigments dilués à l’eau directement sur l’enduit encore frais, dans un moment précis entre humidité et sécheresse. Une technique exigeante, proche de l’aquarelle, mais qui offre des couleurs durables et éclatantes, avec très peu de pigment.
« C’est le moment magique où le jaune rentre juste comme il faut dans l’enduit. »
Impression botanique : la nature comme matrice
Depuis quelques années, Catherine explore aussi l’impression botanique, ou eco print. En posant des feuilles et des fleurs directement sur du tissu préalablement préparé (mortaisé), elle obtient des empreintes végétales uniques. Le tout est cuit à la vapeur pendant plusieurs heures dans une poissonnière.

« On ne peut jamais refaire deux fois le même tissu. C’est la surprise à chaque fois. »
Les fonds varient selon les bains utilisés (vinaigre, jus d’oignon, tanin, etc.), et les plantes réagissent différemment selon leur nature (acide, à tanin, à couleur) et leur saison de récolte. L’oxalis, par exemple, agit comme un agent de blanchiment naturel.
Le travail de la terre : de l’argile locale à la céramique
L’argile extraite directement sur le terrain devient matière première pour la céramique. Catherine la transforme en pains d’argile après l’avoir laissée sécher sur tissu. Elle crée des objets simples mais uniques : carreaux, pions de jeux, petits bols, boutons…
« Je ne veux pas industrialiser le processus. Le plaisir est dans le faire avec les mains. »
Certaines pièces sont polies à la main pour créer de la terre sigillée, puis enfumées dans des braises, donnant un aspect brut et minéral. D’autres sont émaillées à base d’oxydes (comme le cobalt) et cuites dans un four à bois construit sur place.

Un four à bois fait maison
Avec Thierry et l’aide d’amis potiers, Catherine a construit un four à bois capable d’atteindre 1280°C, essentiel pour cuire certaines pièces. Il fonctionne comme un poêle de masse, avec une circulation contrôlée des flammes, optimisant la chauffe tout en restant écologique, en utilisant le bois du terrain.
Retrouver le lien avec les matières
Catherine conclut en partageant ce que ces pratiques lui apportent :
« Ce qui me remplit depuis des années, c’est de faire avec mes mains, avec les matières qui m’entourent. Ça me fait du bien. »
Loin des écrans, ce retour à la matière et au geste manuel résonne comme un appel à ralentir, à créer, à renouer avec le tangible.
Pour Retrouver Catherine et Thierry de Terres de vent : https://linktr.ee/la_roussiere