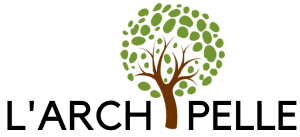Un métier hérité du hasard et de la passion
Rien ne prédestinait Jérémy à devenir forgeron. Technicien du son dans l’événementiel, il vivait la nuit, entre concerts et festivals. Puis la saturation de la vie urbaine, une colocation rurale, et surtout une vieille forge abandonnée au fond d’une grange, ont tout changé.
Par curiosité, il chauffe un morceau de métal sur un feu de bois. La matière rougit, se tord, chante sous le marteau. C’est le déclic. Ce premier échec — un bout de ferraille raté — marque la naissance d’une vocation.

Forger, c’est apprendre à écouter la matière
Le métier de taillandier demande une attention absolue : gérer la main gauche, la main droite, la température, la pression du pied. « C’est en forgeant qu’on devient forgeron », dit le proverbe. Pour Jérémy, cette phrase prend un sens profond : la mémoire du corps.
Comme un musicien répétant ses gammes, le forgeron automatise ses gestes. La main pense à la place de l’esprit. « Le corps intègre le mouvement, et l’artisan devient l’outil. »
Des outils faits pour durer des siècles
Dans son atelier, Jérémy conçoit des marteaux, haches, serpettes ou gouges destinés à traverser le temps. Il s’inspire de techniques anciennes, comme les marteaux à frettes utilisés en montagne, dont la structure renforcée empêche la casse du manche.
L’idée est simple : prolonger la vie de l’outil, limiter les déchets, et retrouver une logique de durabilité. Le bois, dit-il, « se composte, se chauffe, se répare ». À l’inverse, les manches en composite, presque irréparables, symbolisent cette modernité que l’artisan rejette.

Entre tradition et invention
Loin d’être figé dans le passé, Jérémy invente et adapte. Il développe des matrices mécaniques pour optimiser ses gestes, réduire la consommation d’énergie et limiter les chauffes.
Chaque outil est le fruit d’un équilibre entre la tradition — la soudure au feu, utilisée depuis le Moyen Âge — et la modernité, avec parfois l’aide de procédés électriques plus rapides. L’important n’est pas la nostalgie, mais la pertinence : faire juste, solide et durable.

L’outil comme prolongement de la main et du vivant
Les outils de Jérémy ne sortent pas d’une logique industrielle. Ils répondent à des besoins réels : jardiniers, charpentiers, apiculteurs. Certains lui demandent des gouges pour ruches-troncs, afin d’accueillir l’abeille noire, plus rustique et résistante que les variétés industrielles.
Cette attention au vivant lie son travail à une forme d’écologie pratique : fabriquer des objets réparables, utiles, qui réintroduisent de la biodiversité et du sens dans le geste quotidien.
Entre artisanat et industrie : deux visions du monde
« On nous dit souvent : vous êtes chers. Mais l’industrie, elle, fabrique pour jeter. »
Pour Jérémy, le contraste est clair : l’artisanat, c’est le temps, la précision et la durabilité ; l’industrie, c’est la volatilité, la vitesse et le gaspillage. Il cite pourtant Opinel en modèle d’équilibre : une entreprise industrielle qui a su conserver la qualité, la simplicité et la longévité de ses produits.
Être artisan aujourd’hui, c’est parfois se sentir « né dans le mauvais siècle », mais c’est aussi redonner du sens à la matière et au travail bien fait.

La forge comme philosophie de vie
Au fond, le feu de la forge éclaire plus qu’il ne brûle. Pour Jérémy, chaque coup de marteau est une manière de résister à l’obsolescence, de renouer avec un rapport vivant au monde.
Il ne s’agit pas seulement de fabriquer des outils : il s’agit de forger un avenir où le geste artisanal retrouve sa place, où la main se souvient, où la matière vit encore.